
Encyclopédie française
 Architecture
Architecture


L'arc de triomphe de l’Étoile, souvent appelé simplement l'Arc de Triomphe1, est un monument situé à Paris, en un point haut à la jonction des territoires des 8e, 16e et 17e arrondissements, notamment au sommet de l'avenue des Champs-Élysées et de l'avenue de la Grande-Armée, lesquelles constituent un grand axe est-ouest parisien partant de la pyramide du Louvre, passant par l'obélisque de La Concorde, l'Arc de Triomphe lui-même et se terminant au loin par l'Arche de la Défense.
Sa construction, décidée par l'empereur Napoléon Ier, débute en 1806 et s'achève en 1836 sous le règne de Louis-Philippe.

 Architecture
Architecture
 Roman architecture
Roman architecture

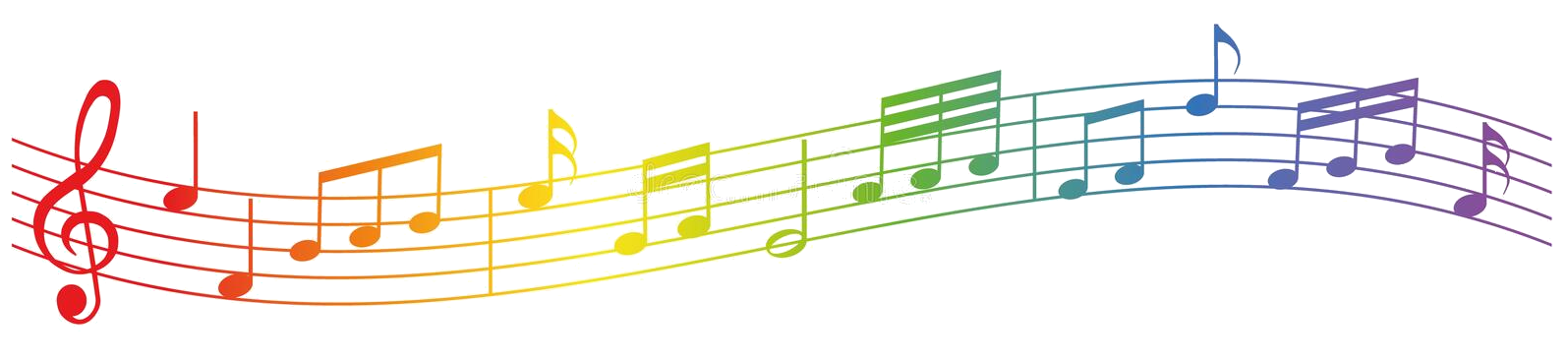 Music
Music
 Music Hall, State Theater, Opera House
Music Hall, State Theater, Opera House

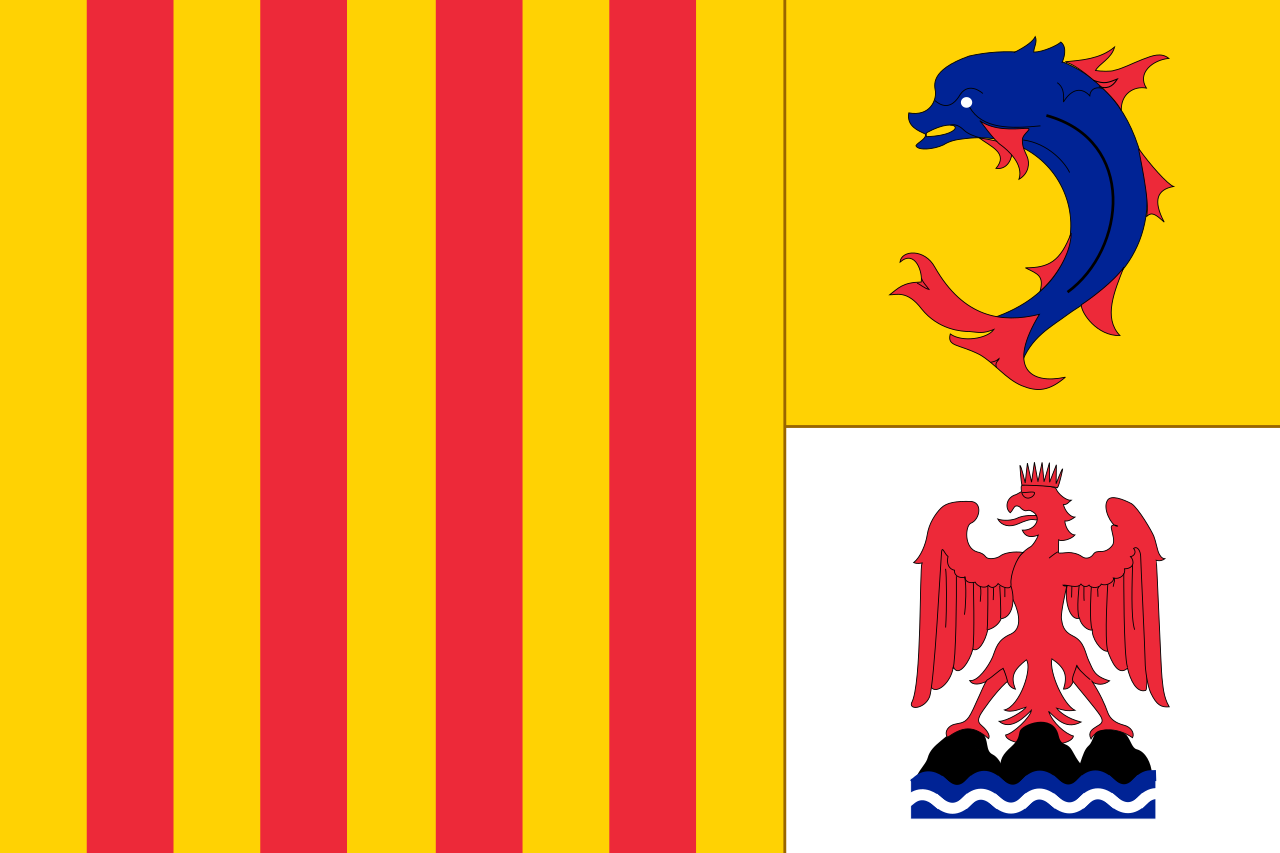 Provence-Alpes-Côte d´Azur
Provence-Alpes-Côte d´Azur

Les Arènes d'Arles sont un amphithéâtre romain construit vers 80-90 apr. J.-C. par les ordres de l’empereur Tibère, dans le cadre des extensions flaviennes de la ville. L’amphithéâtre d'Arles est le monument le plus important de l’ancienne colonie romaine qu'il nous est permis d’admirer, quelque deux millénaires après son édification. Son architecture est entièrement conçue en rapport avec sa vocation de lieu à grands spectacles, accueillant un nombreux public.
Les ingénieurs romains bâtissent l’amphithéâtre d’Arles sur la colline de l’Hauture. Pour ce faire, ils doivent démolir l’enceinte augustéenne érigée un siècle plus tôt.
Les arènes reprennent les caractéristiques classiques de ce type de construction et s'inspirent du Colisée de Rome tout juste terminé : un système d'évacuation par de nombreux couloirs d'accès, une scène centrale de forme elliptique entourée de gradins, des arcades, ici sur deux niveaux, le tout pour une longueur totale de 136 mètres, soit d’une dimension supérieure à celle des arènes de Nîmes construites peu après mais cependant mieux conservées (l'attique de couronnement des arènes d'Arles a malheureusement disparu). Cet édifice pouvait accueillir 25 000 spectateurs.
À Arles, comme dans tout l'Occident, l'amphithéâtre est, de la fin du ier siècle au milieu du iiie siècle, le signe le plus évident de la romanisation.
Histoire
Ce « temple » du jeu où s’affrontent les gladiateurs reste en fonction jusqu’à la fin de l’Empire romain. En 255, l'empereur Gallus y fait organiser des jeux en célébration des victoires remportées par ses armées dans les Gaules. Au début du vie siècle, Constantin y fait représenter de grandes chasses et des combats à l'occasion de la naissance de son fils aîné. Plus tard, Majorien y donne plusieurs spectacles. Enfin, nous savons par Procope, qu'en 539, Childebert, roi de Paris, s'étant rendu dans le midi des Gaules, veut qu'on renouvelle en sa présence les jeux des antiques2.
Des documents historiques montrent qu’il est encore utilisé sous l’épiscopat de CésaireNote 1 et après le passage de la cité sous la domination franqueNote 2, jusque vers 550Note 3.
À la fin du vie siècle, les arènes s'adaptent à la nouvelle réalité du temps : le retour de l'insécurité. Les voilà donc transformées en bastide, sorte de forteresse urbaine qui au fil du temps se dote de quatre tours et dans laquelle s'intègrent plus de deux cents habitations et deux chapelles. Le médecin et géographe Jérome Münzer de passage dans la cité d'Arles en 1495 écrit : « Aujourd'hui, de pauvres gens habitent ce théâtre, ayant leur cahutes dans les cintres et sur l'arène3. »
Le roi François Ier, visitant la ville en 1516, s’en étonne et regrette de trouver un tel édifice dans un si triste état.
Cette fonction résidentielle se perpétue dans le temps avant que l'expropriation commencée dès la fin du xviiie siècle n'aboutisse définitivement en 1825 sous l’impulsion du maire de l’époque, le baron de Chartrouse. Les arènes retrouvent en 1830, lors d’une fête inaugurale à l’occasion de la célébration de la prise d’Alger, le côté festif et dramatique initial pour lequel elles ont été construites, comme une sorte de pérennisation des mœurs romaines, avec le spectacle taurin ce qui lui vaut son appellation courante actuelle d’Arènes. Mais ce n'est que le 30 décembre 1840 que la Commission archéologique fait démolir les dernières maisons adossées à l'amphithéâtre4.
Cet amphithéâtre romain est classé monument historique dès 18401 sur l’initiative de l'écrivain Prosper MériméeNote 4 et en 1981, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les arènes ont également accueilli le jeu télévisé Intervilles en 1998 (contre Martigues) et en 2005 (contre Digne-les-Bains), et la finale entre Pont-Saint-Esprit et Saint-Quentin.

Les arènes de Nîmes sont un amphithéâtre romain construit vers la fin du ier siècle dans la ville française de Nîmes, dans le Gard.
La construction de l'édifice débute vers 90 après J.-C. . Sa fonction est alors d’accueillir des divertissements pour la population de la colonie de Nemausus. Lors des Grandes Invasions, il se transforme en village fortifié où la population va se réfugier, puis constitue du Moyen Âge jusqu'au xixe siècle un quartier avec ses rues et ses boutiques. Au xixe siècle, le monument est dégagé puis reconverti en arène en 1863. Aujourd'hui, il accueille une vingtaine de corridas et courses camarguaises chaque année et diverses manifestations culturelles (concerts, reconstitutions historiques, comme les Grands Jeux Romains, etc.). En dehors de ces événements, l'édifice est ouvert à la visite toute l'année.
Cet amphithéâtre est sans doute, du moins par l'allure générale de sa façade ayant conservé son attique de couronnement avec colonnes engagées et 60 arcades à chaque niveau, son système de circulation publique interne quasi intact et une grande partie de ses gradins (certes dégagés et restaurés au xixe siècle), le mieux conservé au monde. Il n'est cependant pas encore inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, contrairement à son voisin d'Arles pourtant moins bien conservé.
Les arènes de Nîmes font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 18401.
L'amphithéâtre romain
Vue des pierres formant les bases de mât pour tendre le velum, au sommet de trois arcades. À gauche la pierre est cassée, montrant le canon cylindrique.
À Nîmes, un seul monument de spectacle antique peut encore être admiré. Il s’agit de l’amphithéâtre, aujourd’hui appelé « les Arènes », qui est l’un des mieux conservés du monde romain.
Vitruve définit les bases essentielles de ces édifices, qui sont les plus imposants du monde romain : « Il convient de répartir des voies d’accès nombreuses et spacieuses, en évitant que celles qui viennent d’en haut ne rencontrent celles qui viennent d’en bas ; on doit pouvoir les rejoindre à partir de toutes les places, en circuit direct et sans détour, de telle sorte que lorsqu’il quitte le spectacle, le peuple ne soit pas serré, mais trouve, quel que soit le siège qu’il occupait, une issue séparée et sans obstacle ».
L’amphithéâtre de Nîmes, datant de la fin du ier siècle de notre ère, observe bien ces bases essentielles. En plan, l’édifice se présente comme une ellipse de 133 m de long sur 101 m de large, avec une piste centrale de 68 m sur 38 m. La façade, composée de deux niveaux de 60 arcades superposées et d’un attique séparés par une corniche, mesure 21 m de haut. Au sommet de la façade, on observe des pierres en saillie trouées qui servaient à fixer le velum qui pouvait s’étendre au-dessus des gradins pour protéger le public du soleil.
La cavea, entourant la piste, divisée en 60 travées rayonnantes et 34 rangs de gradins, pouvait accueillir 24 000 spectateurs. Les 34 rangs de gradins de la cavea sont répartis en quatre maeniana horizontaux, séparées par un couloir de circulation et un muret, appelé balteus.
Chaque maenianum était réservé à une classe sociale, à savoir les plus aisés aux premiers rangs et les plus modestes aux derniers rangs, et chacun desservi par une galerie voûtée, appelé vomitorium. Les vomitoria sont réunis entre eux par des escaliers, ce qui évite la confusion et l’engorgement lors de l’afflux de spectateurs. Sous la piste, se trouvaient plusieurs galeries souterraines où se situaient les coulisses. L’accès à la piste par les gladiateurs se faisait directement par des escaliers depuis les galeries souterraines. L’édifice présente peu de décors sculptés puisque son architecture suffit à lui donner une allure monumentale. La façade est rythmée par des pilastres et des colonnes engagées d’ordre dorique.
L’amphithéâtre de Nîmes est comparable à celui d’Arles, datant de la fin du ier siècle, qui est très proche sur le plan de la conception et de l’architecture. En effet, l’amphithéâtre d’Arles présente également deux niveaux d’arcades en façade très peu décorées. La cavea de l’édifice se composait de 43 rangées de gradins et pouvait accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs. L’amphithéâtre de Nîmes peut également être mis en relation avec le Colisée de Rome. Le Colisée, terminé en 80 de notre ère aurait servi de modèle dans la construction de l’amphithéâtre de Nîmes, ce qui montre que la ville de Nîmes voulait se rapprocher au mieux de la civilisation romaine. Nous pouvons noter tout de même quelques différences entre les deux édifices. D’abord, nous observons que le plan du Colisée est moins allongé que celui de l’amphithéâtre nîmois. La façade du monument romain se compose de trois niveaux d’arcades, alors que celui de Nîmes n’en comporte que deux.
Ces édifices imposants ont été bâtis pour accueillir des spectacles très prisés des populations. Le spectacle le plus fréquent et le plus apprécié était le combat de gladiateurs. Nous savons qu’il existait des écoles de gladiateurs qui formaient des volontaires, esclaves ou souvent hommes libres. Ces écoles étaient souvent le dernier refuge pour ses hommes déclassés, rejetés par la société. Les combats de gladiateurs se terminaient parfois par la mort de l’un des adversaires si le vaincu n’était pas gracié par le public. Chaque année, fin avril, ces "ludi" (jeux du cirque) sont reconstitués lors des Grands Jeux Romains auxquels participent plus de 500 reconstituteurs spécialistes de l'antiquité.
Bien que monumental, l'amphithéâtre ne comporte que trois éléments décoratifs : la louve romaine allaitant Romulus et Rémus, deux gladiateurs combattant, ainsi que deux bustes de taureau surmontant une des nombreuses arcades de l’amphithéâtre.

Arles est une commune, sous-préfecture, du département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ville, chef-lieu de l'arrondissement d'Arles, est la plus grande commune de France métropolitaine avec quelque 75 893 hectares (malgré plusieurs déductions successives) et la plus peuplée de la Camargue1. La ville est traversée par le Rhône et se trouve entre Nîmes (à 30 km au nord-ouest) et Marseille (à 90 km au sud-est).
Durant l'âge du fer (viiie – iie siècles av. J.-C.), Arles constitue l'un des principaux oppida de la Celtique méditerranéenne2.
Cette ville, dont les habitants sont appelés Arlésiens, a plus de 2 500 ans. Des monuments remarquables ont été construits pendant l’Antiquité à l’époque romaine, comme le théâtre antique, les arènes, les Alyscamps ou encore le cirque romain. En 2008, le plus vieux buste connu de Jules César a été découvert dans le Rhône, à proximité de la ville. En raison de son important patrimoine, la cité est classée Villes et Pays d'art et d'histoire et ses monuments romains et romans sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981.
Ouverte au tourisme qui est la première activité de la ville3, elle accueille de nombreuses festivités tout le long de l’année : en décembre, Drôles de Noëls, en avril, la Feria d'Arles, les rencontres internationales de la photographie pendant l'été, ainsi qu’en septembre, la Fête du riz.
La commune a obtenu deux fleurs au concours des villes et villages fleuris4.

L’Atomium est un monument de Bruxelles, en Belgique, construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1958 et représentant la maille conventionnelle du cristal de fer (structure cubique centrée) agrandie 165 milliards de fois. Il est situé à Laeken sur le plateau du Heysel où eut lieu cette exposition.
L’Atomium a été imaginé par l’ingénieur André Waterkeyn et érigé par les architectes André et Jean Polak pour l’Exposition universelle de 1958 à Bruxelles en Belgique. Il est devenu, au même titre que le Manneken-Pis et la Grand-Place, un symbole de la capitale de la Belgique. Symboliquement, l’Atomium incarne l’audace d’une époque qui a voulu confronter le destin de l’Humanité avec les découvertes scientifiques.C’est un édifice à mi-chemin entre la sculpture et l’architecture qui culmine à 102 m, dont la masse en 1958 est de 2 400 tonnes (2 500 tonnes en 2006). Il se compose d’une charpente d’acier et de trois piliers bipodes portant neuf sphères de 18 mètres de diamètre pour environ 250 tonnes (une à chacune des 8 points et une au milieu) reliées entre elles par 20 tubes de 3,3 mètres de diamètre (12 de 29 mètres de long pour les arêtes du cube et 2 tubes de 23 mètres de long pour les 4 diagonales) et revêtues, à l'origine, d’aluminium.
Sur les neuf sphères, six sont rendues accessibles au public, chacune comportant deux étages principaux et un plancher inférieur réservé au service.
Le Tube central contient l’ascenseur le plus rapide de l’époque (5 m/s) installé par la succursale belge de la firme suisse Schlieren (reprise plus tard par Schindler). Il permet à 22 personnes d’accéder au sommet en 23 secondes. Les escaliers mécaniques installés dans les tubes obliques, comptent parmi les plus longs d’Europe. Le plus grand mesure 35 m de long.
La construction de l’Atomium fut une prouesse technique1,2.
Le peintre Roger Hebbelinck (1912 -1987) et le sculpteur Ernest Salu (1909 -1987) filment avec des droits exclusifs la construction de l’Atomium. Le documentaire « Construction de l’Atomium » (1957 - 26′- réalisation : E. Salu et R. Hebbelinck, musique : Christian Leroy)3 est primé à Anvers en 1958. Un reportage de la télévision belge (RTBF) de Francis Drapier réalisé en 1988 reproduit de larges extraits de ce documentaire4.

Carcassonne Écouter (Carcassona en occitan) est une commune française, préfecture du département de l'Aude dans la région Occitanie.
Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du Carcassès, un pays centré sur la ville de Carcassonne, entre les prémices du Massif Central et les contreforts pyrénéens. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le canal du Midi, l'Aude, le Fresquel, l'Arnouze, le ruisseau de Bazalac, le ruisseau de Malepère, le ruisseau de Fount Guilhen et par divers autres petits cours d'eau.
Carcassonne est une commune urbaine qui compte 46 825 habitants en 2019, après avoir connu une croissance quasiment continue de la population depuis les années 1800. Elle appartient à l'unité urbaine de Carcassonne et fait partie de l'aire d'attraction de Carcassonne. Ses habitants sont appelés les Carcassonnais ou Carcassonnaises. Carcassonne est la ville principale de la Carcassonne Agglo (113 464 habitants en 2018).
Occupée depuis le Néolithique, Carcassonne se trouve dans la plaine de l'Aude entre deux grands axes de circulation reliant l'Atlantique à la mer Méditerranée et le Massif central aux Pyrénées.
La ville est connue pour la Cité de Carcassonne, ensemble architectural médiéval restauré par Viollet-le-Duc au xixe siècle et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 19971.
Localisation
Carcassonne est située dans le Sud de la France à 95 kilomètres au sud-est de Toulouse. Son emplacement stratégique sur la route entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique est connu depuis le Néolithique. La ville se trouve dans un couloir entre la montagne Noire au nord et les Corbières à l'est, la plaine du Lauragais à l'ouest et la vallée de l'Aude au sud. Cette région naturelle est appelée le Carcassès ou le Carcassonnais.
La superficie de la commune est de 65 km2, ce qui est grand comparé aux nombreuses petites communes de l'Aude. La ville est traversée par l'Aude, le Fresquel et le canal du Midi.
Distances kilométriques entre Carcassonne et les capitales régionales (routes/autoroutes) : Ajaccio : 542 km (à vol d'oiseau), Bordeaux : 335 km, Dijon : 637 km, Lille : 986 km, Lyon : 444 km, Marseille : 318 km, Nantes : 678 km, Orléans : 645 km, Paris : 768 km, Rennes : 788 km, Rouen : 877 km, Strasbourg : 929 km, Toulouse : 95 km. La ville la plus proche est Narbonne (62 km).

Le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou (CNAC) – communément appelé « Centre Georges-Pompidou », « Centre Pompidou » ou « Centre Beaubourg », et familièrement « Beaubourg » – est un établissement polyculturel né de la volonté du président Georges Pompidou, grand amateur d'art moderne, de créer au cœur de Paris une institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec les livres, le design, la musique et le cinéma.
Il est situé dans le quartier Saint-Merri, dans le 4e arrondissement de Paris, entre le quartier des Halles, à l'ouest, et le Marais, à l'est.
Il emploie un millier de personnes et a un budget annuel de cent millions d'euros dont 65 millions de subventions de l'État.
Inauguré le 31 janvier 1977, le centre Pompidou a accueilli, en 2016, plus de 3,3 millions de visiteurs (pour en 2013, plus de 8.2 millions de visiteurs). Au sein du musée national d'Art moderne / centre de création industrielle (MNAM / CCI), il conserve l'une des trois plus importantes collections d'art moderne et contemporain au monde avec celle du Museum of Modern Art de New York et de la Tate Modern de Londres, et la première d'Europe avec 100 313 œuvres de 6 396 artistes au 1er janvier 2014.
Il abrite également d'importantes galeries d'expositions temporaires, des salles de spectacles et de cinéma, et la BPI, première bibliothèque publique de lecture en Europe. De part et d'autre de la piazza, deux bâtiments annexes accueillent l'IRCAM et l'atelier Brancusi.
Depuis le 12 mai 2010, la ville de Metz est dotée d'une antenne décentralisée du centre, le centre Pompidou-Metz1. Entre octobre 2011 et septembre 2013, le Centre Pompidou lance une annexe mobile qui se déplace entre les villes de Chaumont, Cambrai, Boulogne-sur-Mer, Libourne, Le Havre et Aubagne2. En mars 2015, le Centre Pompidou Málaga, premier « Centre Pompidou provisoire » situé à l'étranger, sera accueilli pour cinq ans renouvelables sur 6 300 m2 par « El Cubo » de Málaga en Andalousie, où seront présentées 70 œuvres du musée contre un montant d'un million d'euros par an3.
Le Centre Pompidou s’est associé à la région de Bruxelles-Capitale pour créer dans la capitale belge, Bruxelles, en 2020, un musée consacré à l’art moderne et contemporain ainsi qu'à l'architecture moderne et contemporaine. Cet espace de 30 000 m2 occupera un vaste et lumineux bâtiment Art déco de quatre étages qui abrite depuis les années 1930 un garage Citroën, racheté par la région bruxelloise, qui ne dispose pas de pôle culturel emblématique dédié à l'art contemporain, pour 20,5 millions d'euros au constructeur automobile français. Le Centre Pompidou mettra une partie de ses collections d'environ 120 000 œuvres, dont seuls 10 % sont montrées au public, à la disposition du futur musée. Le nom du musée n'a pas encore été fixé mais "Centre Pompidou" devrait figurer dans la future appellation4,5,6.

Le château de Chambord est un château situé dans la commune de Chambord, dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire (France).
Construit au cœur du plus grand parc forestier clos d’Europe (environ 50 km2 ceint par un mur de 32 km de long), il s'agit du plus vaste des châteaux de la Loire. Il bénéficie d'un jardin d'agrément et d'un parc de chasse classés monuments historiques1. Chambord est le seul domaine royal encore intact depuis sa création.
Le site a d'abord accueilli une motte féodale2, ainsi que l'ancien château des comtes de Blois. L'origine du château actuel remonte au xvie siècle et au règne du roi de France François Ier qui supervise son édification à partir de 15193.
Le château et son domaine se sont vu octroyer plusieurs distinctions : inscription au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en 19814,5 ; classement depuis 2000 dans la zone de classement de la région naturelle du Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire6 ainsi que dans le réseau Natura 2000 en 2006. Il est également classé sur la première liste française de monuments historiques en 18407, est reconnu établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) depuis 20058 et constitue l'une des composantes du réseau des résidences royales européennes9.

 Architecture
Architecture
 Neoclassic architecture *
Neoclassic architecture *
 France
France

 History
History
 L 1000 - 1500 AD
L 1000 - 1500 AD

 Ile-de-France
Ile-de-France
 Schloss Fontainebleau
Schloss Fontainebleau

 World Heritage
World Heritage

Le château de Fontainebleau est un château royal de styles principalement Renaissance et classique, près du centre-ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne), à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Paris, en France. Les premières traces d'un château à Fontainebleau remontent au xiie siècle. Les derniers travaux sont effectués au xixe siècle.
Haut lieu de l'histoire de France, le château de Fontainebleau est l'une des demeures des souverains français depuis François Ier, qui en fait sa demeure favorite, jusqu'à Napoléon III. Plusieurs rois laissent leur empreinte dans la construction et l'histoire du château, qui est ainsi un témoin des différentes phases de l'histoire de France depuis le Moyen Âge. Entouré d'un vaste parc et voisin de la forêt de Fontainebleau, le château se compose d'éléments de styles médiévaux, Renaissance, et classiques. Il témoigne de la rencontre entre l'art italien et la tradition française exprimée tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs. Cette spécificité s'explique par la volonté de François Ier de créer à Fontainebleau une « nouvelle Rome »1,N 1 dans laquelle les artistes italiens viennent exprimer leur talent et influencer l'art français. C'est ainsi que naît l'École de Fontainebleau, qui représente la période la plus riche de l'art renaissant en France, et inspire la peinture française jusqu'au milieu du xviie siècle, voire au-delà. Napoléon Ier surnomme ainsi le château la « maison des siècles »2, évoquant par là les souvenirs historiques dont les lieux sont le témoignage.
Le château fait l’objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862, classement complété par plusieurs arrêtés pris en 1913, 1930, 2008 et 20093. Par ailleurs, depuis 1981, le château fait partie avec son parc du patrimoine mondial de l'UNESCO. Riche d'un cadre architectural de premier ordre, le château de Fontainebleau possède également une des plus importantes collections de mobilier ancien de France, et conserve une exceptionnelle collection de peintures, de sculptures, et d'objets d'art, allant du vie au xixe siècle.

 Architecture
Architecture
 Baroque / Rococo architecture
Baroque / Rococo architecture
 France
France

 History
History
 M 1500 - 2000 AD
M 1500 - 2000 AD

 Ile-de-France
Ile-de-France
 Musée national des Châteaux de Versailles et de
Musée national des Châteaux de Versailles et de

 World Heritage
World Heritage

Le château de Versailles est un château et un monument historique situé à Versailles dans les Yvelines, en France. Il fut la résidence principale des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le roi, la cour et le gouvernement y résidèrent de façon permanente du 6 mai 1682 au 6 octobre 1789, à l'exception des années de la Régence de 1715 à 1723. Voulu par Louis XIV afin de glorifier la monarchie française, le château est le plus important monument de son règne et l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture classique. Il exerça une grande influence en Europe aux xviiie et xixe siècles dans le domaine de l'architecture et des arts décoratifs1.
Le château est constitué d'un ensemble complexe de cours et de corps de bâtiments préservant une harmonie architecturale. Il s'étend sur 63 154 m2, répartis en 2 300 pièces dont 1 000 sont affectées au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon2.
Le parc du château de Versailles s'étend sur 815 ha, contre plus de 8 000 ha avant la Révolution françaisenote 1, dont 93 ha de jardins. Il comprend de nombreux éléments, dont le Petit et le Grand Trianon (qui fut la résidence de Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier, et Napoléon III), le hameau de la Reine, le Grand et le Petit Canal, une ménagerie (aujourd’hui détruite), une orangerie et la pièce d'eau des Suisses. Le château de Versailles est situé au nord-ouest du territoire de la commune de Versailles sur la place d'Armes, à 16 kilomètres au sud-ouest de Paris, en France. On entend, par « château de Versailles », à la fois la construction palatiale et ses proches abords, ainsi que l'ensemble du domaine de Versailles, incluant alors — entre autres — les Trianons, le Grand Canal et le parc du château de Versailles.
 Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

 Architecture
Architecture
 Half-timbered house
Half-timbered house

 Eat and Drink
Eat and Drink
 *Wine region
*Wine region
 France
France

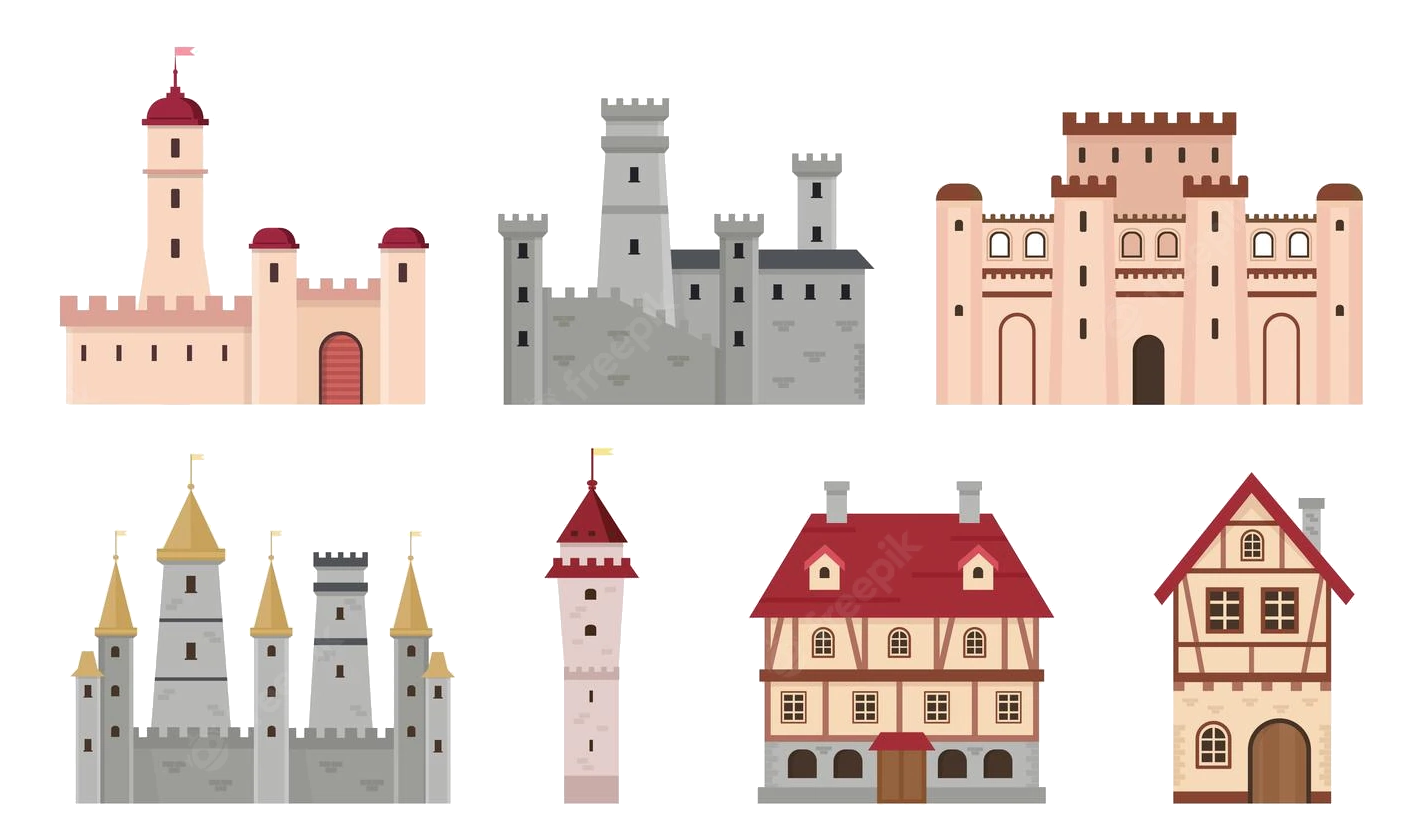 Medieval cities in Europe
Medieval cities in Europe

Colmar est une commune française située dans la collectivité européenne d'Alsace, dans la région Grand Est. Elle est la préfecture du Haut-Rhin et, avec près de 70 000 habitants, la troisième commune alsacienne en nombre d'habitants après Strasbourg et Mulhouse. Ses habitants sont appelés les Colmariens.
Colmar est mentionnée pour la première fois au ixe siècle. Ville libre du Saint-Empire, elle est membre de la Décapole. Elle connaît un développement rapide à la fin du Moyen Âge et au cours de la Renaissance. Dotée d'une ceinture de remparts, elle souffre néanmoins des troubles liés à la Réforme, de la guerre des Paysans puis de la guerre de Trente Ans, à la suite de laquelle elle est annexée par la France. Colmar est cédée à l'Empire allemand en 1871 puis réannexée à la France à la suite de l'armistice de 1918. Bien que n'étant pas chef-lieu de région, Colmar abrite une cour d'appel. Cette particularité (qu'elle partage notamment avec Aix-en-Provence, Douai ou Riom dans des régions dont le chef-lieu n'est pas non plus siège de Cour d'appel) est due à l'élévation de la ville au rang de capitale judiciaire par l'ancien Conseil souverain d'Alsace en 1698.
La ville possède un riche patrimoine architectural, notamment une ancienne collégiale, plusieurs couvents, un théâtre remarquable, des canaux (petite Venise) et des maisons du Moyen Âge. Sa situation, au centre du vignoble alsacien et proche du piémont vosgien, et son climat particulier propice à la culture de la vigne, lui valent le surnom de « capitale des vins d'Alsace ». C'est également une ville de culture, siège du musée Unterlinden abritant le retable d'Issenheim. Colmar est par ailleurs la ville natale du créateur de la statue de la Liberté à New York, Auguste Bartholdi et de Jean-Jacques Waltz, plus connu sous le nom de Hansi.

L’église de la Madeleine se situe sur la place de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris. Elle constitue une parfaite illustration du style architectural néoclassique avec son portique octostyle.
Sa construction s'est étalée sur 85 ans en raison des troubles politiques en France à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Les changements politiques de l'époque en firent modifier à plusieurs reprises la destination et les plans. Conçu par Napoléon Ier comme un temple grec dédié à la gloire de sa Grande Armée en 1806, le bâtiment faillit être transformé en 1837 en gare ferroviaire, la première de Paris, avant de devenir une église en 1845. Sous le fronton, l'inscription en latin « D.O.M. SVB. INVOC. S. M. MAGDALENAE » (« Domino Optimo Maximo sub invocatione Sanctae Mariae Magdalenae ») signifie « Au Dieu très bon et très grand, sous l'invocation de sainte Marie-Madeleine ». L'édifice a une longueur de 108 mètres, une largeur de 43 mètres, une hauteur de 30 mètres et est ceinturé par 52 colonnes corinthiennes.
Ce site est desservi par la station de métro Madeleine.
 Art
Art
 International cities
International cities
 Occitania
Occitania
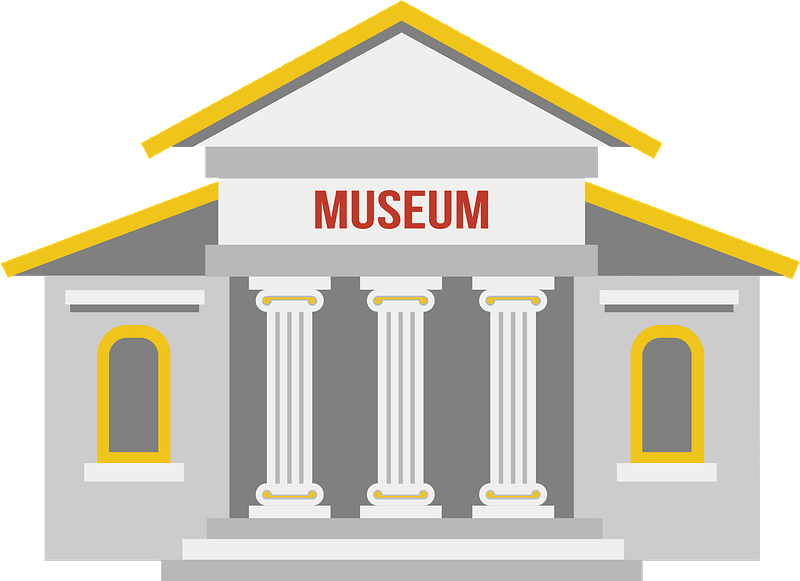 Museum
Museum
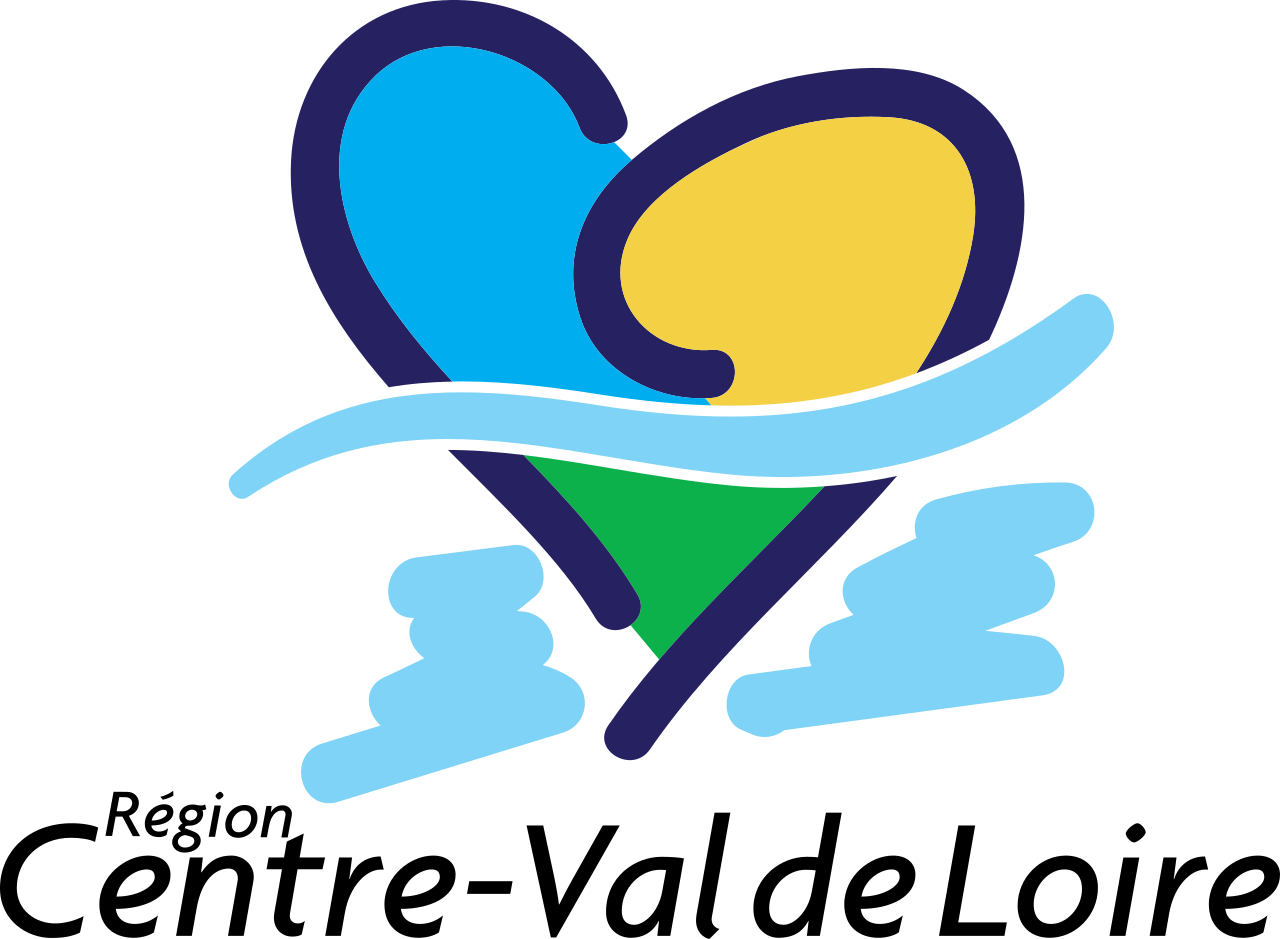 Centre-Val de Loire
Centre-Val de Loire